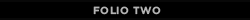
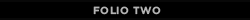
Le détour du rockeur de traverse
Des flopées de totos guitare en main, des cocardes ou des flèches mods récurrentes : dire que l’univers de Jofo a beaucoup à voir avec celui du rock relève du pléonasme. D’autant qu’au delà de emblèmes d’une certaine esthétique éclose en Angleterre dans les années 64-67, il y a ce trait gras, ces formes simplifiées à l’extrème, ces couleurs pétantes. On est pas loin de la violence flashie que reflète la pochette du « screamadelica » de Primal Scream (même si Jofo se dit plus impressionné par celle du « Revolver » des Beatles ou celles des albums des Buzzcocks). On n’est pas loin non plus de la BD, champ culturel fortement imbriqué, en France, dans celui du rock via Serge Clerc ou Denis Sire.
Surtout, cette esthétique de l’immédiateté est fondamentalement rock’n’roll. C’est celle du slogan : « Fuck art, let’s dance, « We want the world and we want it now », We are so pretty vacant and we don’t care »… C’est encore Pete Townshend des Who en 1964, interrogeant : « Pourquoi perdre votre temps à apprendre de fastidieuses suites d’accords alors qu’avec des idées nouvelles sur ce que peut être votre guitare, le monde peut être à vous tout de suite ? ». Le pinceau, substitut de la guitare ?
Pete Townshend ! Jofo se targue d’avoir le même nez proéminent ; « la face du rock aurait été changée s’il avait été plus court ». Et l’album « Tommy » n’aurait peut-être pas eu la même acidité. C’est le premier disque que Jofo achète et sa première hallucina- tion, à 14 ans. Quatre ans plus tard, ayant lu dans « Best » que les Who jouaient à Londres, il se fait envoyer en Angleterre en voyage linguistique. Outre les Who, il en profite aussi pour aller voir Wilko Johnson au Marquee. Et puis, il y a le Festival Punk de Mont-de-Marsan, où il s’incruste au milieu des photographes professionnels avec son instamatic pour prendre des photos des Clash ou des Damned. Et puis un autre concert des Clash en Espagne, la venue de Lou Reed à Bayonne (la veille de son bac). Et enfin Bordeaux : Des études d’architecture alors que les Strychnine, Standards et autres groupes en St refaçonnaient la ville eux aussi.
Car le rock, c’est écrire la ville. Son électricité, sa technologie, sa violence, sa concentration de populations, ses réseaux. A une époque où les municipalités n’imaginent pas d’intégrer les « musiques amplifiées » dans leur politique culturelle en subventionnant des salles de concerts et des locaux de répétition, les guitares se font entendre dans des caves à peine salubres et des bistrots exigus. Chaban-Delmas et Micheline les ignorent ? Tant mieux. C’est l’occasion de dessiner un autre Bordeaux, avec des itinéraires aux allures de parcours du combattant pour qui n’est pas motorisé. Une ville d’énergie, de découvertes et de risques, malgré la désuétude de la production, certains morceaux de ces années 80 gardent un parfum de danger intact dont il est foutrement excitant de devenir un acteur quand on a une vingtaine d’années.
Rockeur sans guitare. Le rock et la peinture plutôt que l’architecture, ce sera donc le choix de Jofo quelque part aux alentours de 1986. Quasiment une évidence. « L’architecture supposait trop de responsabilités, dit-il. C’est un art à habiter, qui détermine le cadre de vie de personnes et qui suppose de passer par toute une chaîne de métiers. Ca ne cadrait pas avec mon besoin d’indépendance. » Son père archi a du mal a comprendre… Rockeur par la peinture, Jofo sera aussi un rockeur sans guitare. Chemins de traverse. Pas la moindre tentative d’apprendre à plaquer un la mineur ou un sol septième. « Je n’ai pas une âme de musicien, j’ai une âme de fan. » Qui avait même monté un groupe fictif à la fin des années 70 avec ses frères dacquois : « On s’appelait les Bollocks. On s’était pris en photo recouverts de mousse à raser, comme les Damned, et on avait fait des affichettes photocopiées pour annoncer des concerts immaginaires. J’étais le bassiste virtuel aux longs doigts ! »
Il relance l’imposture en 1986. A l’école d’archi il a repéré Charles, alors guitariste d’ABB, groupuscule mod. « Il portait une parka et il roulait en Austin mini. La première fois que je lui est parlé, c’était pour le bizuter. » Mais voilà que le bizuté recherche un chanteur pour un nouveau groupe qui s’appellera Les Cons, par référence au « All mod cons » des Jam. Et dans ce groupe il y a Yves, bassiste, dont une amie de Jofo est secrètement amoureuse. Il faut un prétexte pour lui permettre de le rencontrer. Bien que n’ayant jamais tenu un micro de sa vie, Jofo passe une audition, non sans avoir préalablement descendu une bouteille de whisky. « Charles était persuadé que je me foutais de leur gueule. » Pourtant Yves trouve l’âme soeur et le chanteur escroc est recruté.
Mais il est vrai que le rock’n’roll est fondamentalement une affaire d’escrocs. On le sait depuis les Sex Pistols. Et Lou Reed. Et Boris Vian. Et John Lee Hooker. A quoi bon s’appliquer à travailler sa voix, à polir chaque syllabe, si c’est pour dépeindre une réalité crue et acide ? A quoi bon faire de la poésie, livrer un « message », quand un leitmotiv basique comme « shake it babe » contient tout ce qu’il faut de sens concentrés et de rythme pour chambouler des millions de cerveaux ? A quoi bon se préoccuper de la culture ?
Les Cons, vaste sujet… Escrocs, les Cons le seront donc pendant trois années de bordel jouissif. Leur premier concert, après seulement un mois de répétitions, se fera en première partie de Bagarre (les futurs Wet Furs) et donnera lieu à une affiche historique : « bagarre avec les Cons ». Au New moon de Paris, où des hippies se produisaient, ils profitent d’une pause pour emprunter leurs instruments qu’ils cassent avant de décarrer. A Biarritz un concert privé donné à l’occasion d’un mariage finit en bagarre générale. Les cons jouent mal, bousillent leurs instruments, et pourtant ils font le plein à leurs concerts en croisant compos originales (« le langage des filles », « yé yé yé ») et reprises adaptées en français à la manière de Ronnie Bird (« Chaban », d’après « A bomb in wardour street » des Jam, ou « no dance », repompé sur « girls in black » des Troggs).
Quand il évoque cette époque, Jofo déplore d’avoir dû gueuler pour couvrir le boucan que faisait le groupe. Oui, mais les mélodies qu’il chantait étaient de vraies mélodies et, gueulées de cette façon, avec ce timbre de voix grave, à la fois déchiré et détaché, elles faisaient mouche. Force de tirer le maximum de ses maigres capacités vocales, l’homme gagnait en conviction, en substance et en élégance. C’est quand on est dos au mur qu’on est contraint de sortir ce qu’on a de plus efficace.
Vingt ans plus tard, dans ce qui est devenu The Snoc (toujours avec charles), Jofo a quasiment renoncé aux mélodies pour privilégier le talk-over à la manière de Gainsbourg. « Lui aussi il a un long nez et « Mélodiy Nelson » reste un de mes albums cultes. » Dans la manière d’attaquer les syllabes on serait aussi tenté de retrouver des échos de Coronados ; il ne démentira pas. Le fait est que le timbre profond et amer demeure, portant souvent une mélodie sous-jacente et s’avérant au final assez unique. « Je ne fais aucun effort avec ma voix, décrète Jofo. Je n’ai pas envi de m’attaquer à un apprentissage technique. J’ai la même approche dans mes chansons et dans ma peinture : le degré zéro de la technique, le trait et l’aplat. »
Même refrain pour les textes. S’il se targue de n’avoir jamais passé plus de vingt minutes sur des paroles de chansons, Jofo n’en est pas moins un authentique auteur, dont l’une des forces est d’avoir compris ce qui fait les grandes pop-songs : l’aptitude à caler des mots qui parlent au plus grand nombre sur des guitares implacables. Ne pas se tromper : ce qui crée l’émotion dans une chanson, c’est d’abord la musique. Le texte ne peux qu’enrichir cette émotion en en fixant le sens avec plus ou moins de talent.
Les textes de Jofo viennent donc quasiment toujours après la musique et ils évoquent forcément des histoires d’amour ou des aspects de la vie quotidienne. Comme « quoi faire ? », dont l’idée lui est venue d’un de ces post-it sur lesquels on note ses obligations quotidiennes, ou « la garce » », qui détourne la formule « en cas de perte de votre carte bleue, appelez le… » en « en cas de perte de ta petite copine, appelle le… ». Une approche simple mais efficace, qui permet en tout cas d’éviter le double écueil du nombrilisme autobiographique, qualité rare ces temps-ci dans la chanson francophone, et du messagisme. « je n’ai aucun engagement. Le seul morceau dans lequel je parle de l’actualité, c’est « Libération », pour en arriver à dire que je préfère ne pas savoir. »
Mod en France : la cocarde inversée. Cette Façon de voir, de penser et d’écrire, il la doit largement à son anglophilie. Affaire de musique évidemment. Souvenir d’un premier voyage Outre-Manche à 13 ans où il avait dormi dans une chambre tapissée de posters de Bowie ou de T.Rex. « Moi qui avais eu une éducation assez catho je me retrouvais dans un univers de platform boots, de maquillage et d’ambiguïté sexuelle. » Souvenir d’un concert des Jam en 1982 aussi, avec affrontements entre skins et mods, violence incroyable et classe absolue.
Mais il y a plus : la seconde guerre mondiale, dans laquelle le Royaume-Uni a joué un rôle fondamental, et les avions britanniques des années 40 qui fascinent Jofo depuis des lustres. Une autre réminiscence de « Tommy » ? Or ces cocardes bleu (à l’extérieur) – blanc – rouge (à l’intérieur) qui étaient peintes sur les Spitfires et les Hurricanes sont aussi celles qu’arborent les mods depuis les années 60 : des symboles de liberté et de fierté.
Angleterre et France : vieille histoire amour-haine. Et Jofo évoque aussi l’influence des Dogs (vu 20 fois), des Coronados, de Daniel Darc ou, dernièrement, de Katerine. « Je n’avais jamais vu un français avec une telle aisance sur scène. Katerine est un artiste complet, qui, outre la chanson, a aussi une expérience de la vidéo, et travaille actuellement avec une chorégraphe. J’aime ce genre de trajectoire. Le risque de se perdre entre les différentes disciplines est réel, mais c’est aussi un moyen de se ressourcer. Si à un moment tu sens que tu n’as rien à raconter dans un domaine, tu passes à un autre et quand tu reviens au premier tu te sens des ailes. » Tout est dit, non ?
Christophe Loubès
Rebaptisée The Snoc! la bande à Jofo chante les amours déconfits, les passsions ravageuses, les rêves fantasmés, l’information hallucinante, le capitalisme communiste, l’insoutenable monde de l’art, l’insouciance, le monde virtuel et sexy de myspace.com, le clin d’oeil à leurs idoles du rock… Le combo nouveau revendique sans complexes l’influence de la puissance du rock de sa magesté la Reine d’Angleterre, The Who, The Jam et la fausse légèreté des chansons Gaullienne de Gainsbourg, Dutronc, Ronny Bird, vaste sujet ! « Chasse Spleen » est le nom de leur premier album.